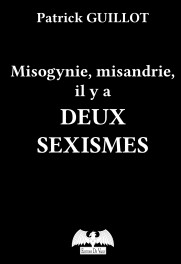L’injustice ménagère (Introduction). François de Singly, 2007
.
[La misandrie s’alimente entre autres à l’accusation récurrente de parasitisme, laquelle se nourrit du thème inusable de la sous-effectuation des travaux domestiques par les hommes. Le sociologue François de Singly, peu suspect d’antiféminisme, resitue ici le problème, montrant que les couples, pour gérer leur vie commune, se réfèrent à d’autres valeurs que celles que les idéologues misandres prétendent leur imposer.]
.
Original, ce livre en France l’est car les études en sciences sociales sur le travail domestique se limitent à compter et recompter les heures (1) pour observer ce qui semble quasi-immuable : les femmes assurent toujours plus que leur part des tâches ménagères et éducatives.
La méfiance pour les " représentations ", pour le sens subjectif que les individus donnent à leurs pratiques dans les travaux sur les inégalités conduit à une impasse. En effet un tel constat ne permet pas de comprendre la manière dont les femmes (et les hommes) justifient ce qui est construit, d’un point de vue objectif, comme " inégalité ", la manière dont les femmes (et les hommes) donnent sens à la division du travail, domestique et professionnel. Dans les pays anglo-saxons, il en est autrement surtout depuis le travail de référence de Linda Thompson (1991) qui a voulu découvrir comment les femmes et les hommes rendent compte de cette inégalité, comment les unes et les autres mobilisent le sens de la justice ou de l’équité au sein des relations conjugales. Selon Thompson, l’acceptation relative de cette inégalité dérive de trois dimensions : les " revenus " tirés de la vie conjugale, la nature des comparaisons, et les justifications.
Le premier facteur - les " revenus "- désigne ce que les conjoints attendent d’une relation. En effet ce n’est pas parce que l’égalité est une valeur en soi qu’elle occupe une des premières places dans la hiérarchie des valeurs pour la vie à deux. C’est ainsi que dans un sondage passé auprès d’un échantillon représentatif de femmes (2), la qualité " avoir un conjoint qui partage le travail ménager " vient en dernière place, bien loin derrière la fidélité, la complicité, l’attention (3)…
Cet indicateur révèle que le choix du conjoint résulte d’une combinaison de plusieurs éléments dont l’égalité. Rien ne prouve que cette dernière occupe une position centrale dans les arbitrages que les unes et les autres font pour juger et leur partenaire et leur vie conjugale.
Dans un autre travail, on découvre que la " valeur " du mari peut être associée, pour son épouse, à la possibilité que son homme l’aidera si elle en a vraiment besoin, plus qu’à un partage égal (Baxter, Western, 1998). Par analogie, on pourrait comparer un conjoint à un ami idéal c’est-à-dire à quelqu’un sur qui on peut compter (Bidart, 1997) sans que la preuve soit nécessairement quotidiennement apportée. Des " récompenses " peuvent être tirées aussi de la reconnaissance que le partenaire donne en retour du travail effectué. Ainsi selon Alan J. Hawkins, Christina M. Marshall et Kathryn M. Meiners (1995), l’élément le plus nettement associé au sentiment de justice éprouvé par la femme est le fait que le mari apprécie le travail ménager ou éducatif assuré par son épouse. L’indifférence est mal vécue puisque l’engagement dans un tel travail perd alors sa signification.
Le deuxième facteur du modèle de Thompson intervenant dans l’aveuglement (partiel) devant l’inégalité objective entre les conjoints repose sur la nature des comparaisons. Tout ne se joue pas dans le cercle clos du couple : la femme peut comparer son temps de travail domestique, non à celui de son compagnon, mais à celui de sa mère, ou encore à celui d’une amie. Le déplacement d’une comparaison interne au couple à une comparaison externe autorise - selon le choix retenu - une certaine satisfaction, son sort paraissant meilleur que celui d’une femme de la génération précédente ou contemporaine. François Dubet retrouve ce phénomène dans l’estimation des inégalités au travail professionnel (2006).
Le troisième facteur est celui des justifications. Linda Thompson analyse la catégorie des " excuses " des hommes : leur manque de temps, leur manque de compétence, leur plus faible standard vis-à-vis du propre, du rangé (4) , ces arguments renvoyant aux identités statutaires de la femme et de l’homme, ou à une conception idéologique de la famille. Elle montre l’existence d’une autre justification : non plus le fait d’être né-e " femme " ou " homme ", mais les goûts personnels. Comme dans la seconde modernité la dimension statutaire de l’identité a perdu de sa légitimité au profit de la dimension personnelle (Beck, 2001 ; Singly, 1996), l’argument des " goûts " devient plus facilement dicible - contrairement à celui du " genre ", la femme pouvant se sentir prisonnière de son sexe.
L’égalité et les autres enjeux
On se situe dans cette perspective ouverte par Thompson en analysant les manières dont les femmes expliquent la division du travail à l’intérieur de leur couple. On appelle par commodité toutes ces raisons des " justifications ". Mais la totalité de ces raisons n’appartiennent pas à la catégorie des justifications reposant sur une notion d’égalité.
Certaines raisons avancées renvoient à d’autres enjeux. François Dubet (2006), pour le travail professionnel, distingue l’égalité, le mérite et l’autonomie. Ces trois ordres servent à l’individu pour juger si ce qu’il subit, si ce qu’il fait est juste ou non. Cette pluralité des critères de jugement se retrouve dans la vie privée, et notamment pour le travail domestique. La pluralité des fonctions de la vie conjugale pour la femme (l’homme) n’inscrit pas exclusivement sur le registre de l’égalité. Ou pour l’énoncer autrement, l’entrée dans la vie conjugale n’est pas motivée uniquement par le souhait de vivre dans un monde égal. On peut aussi chercher à avoir une reconnaissance personnelle, difficile à avoir dans d’autres sphères. Il y a donc des justifications qui appartiennent à l’égalité, et d’autres " justifications " qui relèvent d’une autre logique, notamment celle de savoir si ce qui je fais pour le couple est reconnu (logique du mérite), et celle de savoir si je peux organiser ce que j’ai à faire comme je le veux et ainsi pouvoir m’exprimer. Par exemple quand quelqu’un explique une de ses actions en affirmant que c’est son " choix ", il a recours à une notion, non de l’égalité, mais à de l’autonomie : il a le droit, estime-t-il, d’agir comme bon lui semble.
Cette recherche voudrait, par l’analyse des justifications au sens large à voir la place qu’occupe le souci de l’égalité entre les conjoints hétérosexuels, entre les genres à l’intérieur de la vie privée (justifications au sens restreint). Elle repose donc sur le postulat selon lequel l’engagement dans la vie conjugale, et son mode de fonctionnement, ne dépend pas exclusivement de la domination masculine, c’est-à-dire d’une " grandeur " masculine telle qu’elle pourrait justifier l’évitement du travail domestique. La domination masculine s’exerce à travers cette division du travail, mais elle coexiste avec d’autres exigences, notamment celle qui permet à chacun des conjoints d’avoir le sentiment d’être bien dans son genre.
C’est ce qui produit une distanciation critique au " genre " partielle. Elle dépend du mauvais genre, mais à d’autres moments, en filigrane le plus souvent, les individus mettent en avant quelque chose qui leur semble le plus personnel et qui est en même temps associée à la catégorie socialement construite " femme " ou " homme ".
Ecoutons une femme qui veut donner les raisons qui font que son couple dure (5). Elle a 56 ans et affiche 32 ans de mariage : " Un jour j’ai vu mon mari recoudre un bouton. Je me suis sentie très vexée, je n’ai pas compris pourquoi il ne m’avait pas demandé de lui rendre ce service. Ayant remarqué ma colère et ma tristesse, il m’a fait une petite fleur en papier crépon. Cette petite attention m’a tellement touchée que cette fleur trône toujours fièrement dans la salle de bains, c’était il y a plus de dix ans ". Dans ce petit récit, cette femme avoue avoir été déçue parce que son compagnon, en effectuant une tâche " féminine ", pouvait laisser supposer qu’elle était incompétente. Elle ne comprend pas un tel doute, un tel manque de reconnaissance de ses compétences.
Dans certaines activités - y compris sexuelles - l’individu veut faire preuve de ses capacités personnelles, or et c’est là que le " mauvais " et le " bon " genre font bon - ou mauvais ? - ménage, ces capacités peuvent inclure des compétences sexuées. Anne-Marie interprète le geste de Gilles comme un déni de ses compétences, d’où son malheur. Gilles lui offre un cadeau, paradoxal cependant puisqu’il s’agit encore de quelque chose qu’une femme fabrique plus souvent qu’un homme, une fleur en papier crépon. Cependant Anne-Marie ne veut voir que le rituel de réparation.
Cette histoire peut sembler caricaturale. Or elle permet de poser une question que la critique des inégalités occulte trop souvent, celle de la reconnaissance de ses compétences personnelles. Dans la mesure où ils ne rejettent pas le fait d’être homme ou femme, les hommes et les femmes cherchent à faire valider et à se prouver et qu’ils sont bien " homme " ou " femme ", au moins à certains moments. L’enjeu n’est pas alors celui de la domination, il est celui de la construction identitaire.
La frontière est mobile entre la reconnaissance de soi en tant que " femme " (ou " homme ") et la méconnaissance de soi en tant que " femme " (ou " homme "). Dans la vie quotidienne, une femme peut percevoir certains pratiques comme agressives (par exemple devoir la lessive parce que femme) ou au contraire comme un hommage. Le " genre " exprime deux choses très différentes, soit la domination masculine qui réduit la femme à un " objet ", soit une des dimensions de son identité personnelle et qui, à ce titre, doit être reconnue (7) .
Les critiques énoncées par le mouvement des femmes dans les années 1970 sur les soutiens-gorge, sur les sous-vêtements n’ont pas eu le succès attendu. Pour deux raisons, sous la pression du marché bien évidemment, mais aussi parce qu’un certain nombre de femmes estiment que la lingerie constitue un des supports de leur vécu personnel de leur identité féminine. On peut accuser ces femmes d’aveuglement, d’aliénation, mais cela n’a aucun effet tant qu’on ne donne pas en même temps une réponse concernant les " bonnes " formes de l’expression d’un soi féminin (ou masculin).
En attendant, les femmes (et les hommes) empruntent aux réponses existantes la manière dont elles (ils) peuvent démontrer que leur identité personnelle n’est pas amputée, que celle-ci est complète. Les activités performatives qui produisent le genre comprennent, pour une part, le travail domestique : non seulement certaines femmes assimilent certaines tâches à des preuves de leur identité sexuée (faire un gâteau pour se prouver et prouver que l’on est une bonne mère), mais aussi bien des hommes rechignent à les assumer, pas seulement par paresse, mais aussi pour éviter le risque d’une certaine féminisation de leur identité.
Certains hommes " au foyer " (Merla, 2006) déclarent que cela ne les gêne pas de faire la quasi-totalité de ce que font des femmes au foyer en avançant un argument reposant sur une identité personnelle plus complexe.
Ainsi Claude, définissant le terme " homme " de deux manières différentes, déclare : " Je sens petit à petit l’équilibre se refaire en moi entre le pôle masculin et le pôle féminin. Donc paradoxalement ce qui fait que je me sens plus homme aujourd’hui c’est parce que toute la dimension d’émotion, de fragilité, d’écoute, de réceptivité, d’attention, de rapport au temps qui a changé. Ce qui ne veut pas dire que le pôle masculin a disparu, il est équilibré par un pôle féminin qui a repris sa juste place, ce qui fait que je me sens de plus en plus homme ". Claude parvient à faire des activités considérées socialement comme " féminines ", estimant que cela l’autorise à un épanouissement plus grand de la totalité de son identité. Il ne conteste pas que certaines tâches lui semblent développer plus des " côtés " féminins.
Un autre homme, Christophe, avance la même idée : " Je suis quelqu’un qui ne refoule pas sa féminité ". Il se sent artiste, et pense que cette appartenance requiert un poids plus grand de la " part féminine ". Et il critique les hommes qui refoulent cette part et qui de ce fait sont " complètement à côté " (de soi). Pour cet homme, il ne s’agit pas d’une indifférence à sa dimension sexuée car il se remémore pendant l’entretien un petit film qu’un ami avait pris de lui à l’école des beaux-arts, et où il s’était rendu compte à travers ses gestes : " Vu de derrière, j’avais l’impression que j’étais une femme. Je bougeais, je me dandinais. Je dis : ’on dirait vraiment un pédé’ ".
Cet homme au foyer qui déclare admettre une part féminine ne veut absolument pas être pris pour une femme, ou pour son équivalent dans le monde des hommes (selon lui), " un pédé ".
De tels énoncés montrent que l’effectuation du travail domestique (et professionnel) soulève de nombreux enjeux qui ne peuvent pas être réduits à l’unique logique de l’égalité et de l’inégalité. Pour ces deux hommes au foyer, le codage social de tâches domestiques féminines ne les rebute pas, acceptant d’inclure une dose de " féminin " de leur identité à la condition que cela n’affecte pas leur genre dans le cadre des pratiques sexuelles.
Etre conforme à son genre, avoir le " bon genre " est aussi nécessaire qu’être quelqu’un qui est " juste " en cherchant à être dans une relation égalitaire, ou à l’obtenir. La confrontation de ces exigences sous tension s’achève, encore, par un compromis qui est désavantageux du point de vue de l’égalité pour la femme en couple. Ce compromis n’est pas établi parce qu’en amour on ne compte pas et qu’en conséquence les femmes se font rouler dans la farine romantique. Elles savent bien que la division du travail domestique n’est pas fondée sur le principe de l’égalité, l’aveuglement, même amoureux, n’est jamais à ce degré ! Elles ne peuvent pas faire autrement en raison de la domination et de ses ruses, et elles acceptent, pour une part (variable) pour des motifs qui appartiennent au " genre " identitaire.
.
François de Singly, Introduction à L’injustice ménagère. A. Colin, 2007
.
(1) A l’exception de La trame conjugale de Jean-Claude Kaufman. Cet effet de comptabilité vient, pour une part, de l’existence des enquêtes INSEE Emplois du temps, réalisés dans une optique féministe, et répétée depuis 1974.
(2) Sondage national Ifop-Emap femmes, février 1999
(3) Le texte de la question : "Classez, pour vous, ce que vous recherchez le plus chez votre conjoint, compagnon ou compagne : quelqu’un de fidèle ; avec qui vous êtes complice ; qui fasse attention à vous, vous écoute ; qui fasse bien l’amour avec vous ; avec qui vous êtes heureux, heureuse d’avoir des enfants ; qui sache partager les travaux ménagers avec vous ; qui vous apporte la sécurité"
(4) Développés aussi par J.-C. Kaufman (1992)
(5) E. Sabban, "Les secrets des couples heureux", Nous deux, 15 août 2006
(6) Une dimension identitaire doit être validée par soi et par autrui, étant donné qu’elle est une dimension du monde de l’individu (Berger, Luckman, 2006)
(7) Cf. aussi sur ce dédoublement, I.Clair, 2007
Imprimer